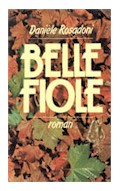 Belle-Fiole a été édité aux éditions Jean-Claude Lattès en 1980 (n° d’édition, 80037). Le livre est épuisé et les éditions Lattès n’en ont plus les droits. On peut s’adresser à l’auteur pour se le procurer. Il est en outre disponible en consultation, au C.D.I. du lycée Marguerite de Navarre, ainsi qu’à la médiathèque et dans le Réseau des Bibliothèques de Bourges.
Belle-Fiole a été édité aux éditions Jean-Claude Lattès en 1980 (n° d’édition, 80037). Le livre est épuisé et les éditions Lattès n’en ont plus les droits. On peut s’adresser à l’auteur pour se le procurer. Il est en outre disponible en consultation, au C.D.I. du lycée Marguerite de Navarre, ainsi qu’à la médiathèque et dans le Réseau des Bibliothèques de Bourges.
Madame Danièle Rosadoni, que nous avons contactée, nous a autorisé à publier les extraits reproduits ci-dessous. Qu’elle en soit ici infiniment remerciée. Ces extraits ne sont pas libres de droits. Tout usage et toute reproduction de ces textes sont soumis à l’autorisation préalable de leur auteur.
BELLE-FIOLE
Oui, décidément, je pleure tout le temps. Et si j’en juge par mon aspect actuel quand je pleure - les yeux pochés, le nez enflé, les lèvres raidies, tout le visage marbré de rouge - mes constantes larmes d’enfant ne devaient pas me rendre plaisante à regarder.
[...]
D’ailleurs, à la maison, on m’appelle « Laiterie de Belle-Fiole ». Tout le monde sait qu’il faut comprendre « laiderie » pour « laiterie », et Belle-Fiole par antiphrase. C’est mon père qui a trouvé le surnom. Le hasard a voulu qu’une laiterie s’appelât ainsi près de son village natal. Je suis Laiterie de Belle-Fiole, d’abord parce que j’ai une grande gueule que je tords tout le temps, que je sûte, que je n’arrête pas de sûter - et je pleure chaque fois que papa rit de moi en m’appelant Laiterie de Belle-Fiole - ensuite parce que j’ai le teint « jaune », la nature m’ayant refusé les bonnes couleurs campagnardes, de même qu’elle m’a refusé les joues rebondies qui en sont généralement le support. Ainsi que mon père le dit souvent :
— Celle-là, a pourrait biger une chieuv’ entre les deux cornes.
Et certes, il faut avoir les joues creuses pour pouvoir poser ses lèvres sur le front d’une chèvre entre les deux cornes. J’ai l’air maigre. Seulement l’air, car moi qui suis « en dessous », pleine de dissimulation et de mensonge, je le suis aussi physiquement. J’ai l’air maigre, et je ne le suis pas, de même que j’ai l’air grande et que c’est pour mieux tromper le monde.
Belle-Fiole, J.C. Lattes, 1980, page 51 et suivantes. © Danielle Rosadoni
« J’VAS T’FAIRE DANSER, MA FEIGNANTE »
Les séances d’écossage des haricots ne se passent guère sans que je finisse par danser. C’est si long et si ennuyeux d’écosser les haricots ! Et il y en a toujours tant ! Assise par terre, un saladier entre les genoux, les bottes de haricots blonds près de moi, je n’en vois pas la fin : détacher une rame du bouquet, les restes de terre encore accrochés aux racines tombant en fine poussière, détacher les cosses de la rame, faire craquer la cosse qui déverse ses grains dans le saladier, prendre garde à ceux qui sont charançonnés tout en ayant la perspective, ensuite, de trier un par un chaque haricot en le retournant sur ses deux faces pour détecter les points bleus ou noirs qui marquent le logis des charançons... Je traîne, je soupire : encore une cosse, encore une rame... Je pose les rames dépouillées à droite, et il y en a toujours autant à gauche. Je vais encore y passer tout l’après-midi, c’est désespérant. Je me lève pour me dégourdir les jambes, dans l’attente de je ne sais quel miracle qui m’affranchirait de cette corvée. Ma mère surgit.
— T’as fini ?... C’est tout c’ que t’as fait ? Par exemple ! Trois heures qu’aile est là à s’ tourner les pouces pendant qu’ les aut’es i travaillent !
Elle s’empare d’une rame nue.
— Ah ! j’ vas t’ les dégourdir, les jambes, moi, j’ vas t’ faire danser, ma feignante.
Elle fouaille, et, levant les jambes alternativement sous les coups, je danse... La rame casse, ma mère attrape la balayette et continue à me frapper. Je ne danse plus parce qu’elle vient de me découper un pont-levis au creux du genou. Je me baisse, elle m’en voie la balayette sur la tête, je tombe et me cogne contre le mur. Elle me relève d’une gifle.
— La v’là qui saigne du nez, à présent. Ça t’apprendra. Lève les bras en l’air !
Quand on saigne du nez, il faut lever les bras à la verticale de chaque côté des oreilles parce que ça arrête le saignement. Mes larmes coulent, mon nez coule, de morve et de sang, cela atteint ma bouche, je m’essuie d’un revers de main, et je reçois de nouvelles gifles.
— J’ t’ai dit d’ lever les bras !
Je les relève, je hoquette, j’ai la tête lourde, je suis à moitié assommée, mes bras en l’air sont d’un poids insupportable, ils se replient, s’abaissent et se redressent aussitôt sous les gifles.
— Lève les bras, misérable, ou j’ t’écrase comme une merde.
Mon nez continue de couler, il me semble que j’ai le cou mouillé, je ferme les yeux, je ne sais plus où je suis.
— Eh ben, Marcelle, qu’est-ce qu’i y a ?
C’est la voix douce de Tatate Ninette, la jeune soeur de ma mère.
— Tu sais, j’ crois pas qu’ ça s’arrêtera comme ça, vaut mieux pas insister
Elle m’essuie le visage et le cou, me fait tenir mon mouchoir sous mon nez et m’emmène chez le pharmacien. Elle restera ensuite à bavarder tranquillement avec ma mère et je reprendrai ma corvée de haricots. La prochaine fois, j’irai sans doute plus vite.
Demain, pour aller à l’école, je marcherai en rasant les murs, à demi accroupie dans l’espoir que ma jupe cachera sur mes jambes les traces de la danse et les ponts-levis dont je meurs de honte.
« Ah ! tu vas êt’e jolie, dame, tu vas avoir belle allure ! » répète ma mère en me frappant et en m’imprimant les mar ques infamantes qui me désignent à toute l’école, aux gens du village, comme le monstre de vice et de méchanceté que je suis.
Belle-Fiole, J.C. Lattes, 1980, page 13 et suivantes. © Danielle Rosadoni
UNE MERE « EXEMPLAIRE »
Ma mère n’est si sévère et si intransigeante que par excès de vertu. Elle est catholique, elle est une sainte femme, elle est une mère exemplaire, tout le monde le sait. Ses principes ne souffrent pas d’exception et ses ordres ne souffrent pas le moindre retard dans leur exécution. Elle est investie d’un devoir sacré qu’elle respecte sans faiblir : bien élever ses enfants.
Les enfants doivent, d’abord et avant tout, obéir, et à l’instant même, sans discuter et sans répondre. Ils n’ont pas à avoir de volonté propre, ils doivent « plier ». Ils doivent aussi, bien sûr, la respecter. C’est même peut-être cet article-là qui contient tous les autres. Une mère a toujours raison puisqu’elle est une mère. Elle suit toujours sa conscience qui est toujours juste puisqu’elle ne songe qu’au bien de ses enfants. Répondre ou manifester une velléité de désobéissance est donc un signe d’irrespect criminel qui doit être châtié. Nous en sommes convaincus.
— Viens ici chercher une volée.
Non seulement il ne nous vient pas à l’esprit de nous sauver, mais encore nous nous approchons sans hésiter pour recevoir la volée, sachant qu’une allure un peu trop lente aggraverait démesurément notre faute. Ma mère est très fière de notre docilité, elle s’en vante. Elle ironise avec mépris sur les parents qui tolèrent la fuite de leurs enfants quand, manifestement, ceux-ci vont être battus. Elle a même vu certaine voisine s’abaisser jusqu’à courir derrière son fils avec le martinet. Ah ! ce n’est pas à elle qu’arriverait pareille mésaventure ! D’ailleurs, elle trouve ridicule la présence d’un martinet dans une maison. Pourquoi donc un instrument spécial pour fouetter un enfant quand n’importe quoi fait si bien l’affaire ? Plus ridicule encore, et plus méprisable, l’attitude des parents qui semblent regretter d’avoir donné une cor rection.
— On tape, pis après on embrasse et on dit : « Allez, c’est fini, on n’en parle pus. » A quoi ça r’semb’e ?
Elle, elle ne varie pas dans ses comportements et elle ne regrette jamais. Elle reste inflexible, mais elle est juste et droite, elle le sait, puisqu’elle n’agit que selon les exigences de sa conscience. Loin de s’adoucir après un châtiment, elle le prolongera, s’il est nécessaire, pour nous ôter l’envie de recommencer.
Belle-Fiole, J.C. Lattes, 1980, page 15 et suivantes. © Danielle Rosadoni
DECOUVERTE DE LA POESIE
Peut-être est-ce dans le té de paille et de cartes postales des Gerbeaux que j’ai contracté mon habitude de rester longtemps, le plus longtemps possible, aux cabinets, ce monde à la fois défendu et inviolable où l’on pouvait prendre le risque de lire. Monde défendu parce que, si l’on avait évidemment le droit de s’y rendre, on n’avait pas celui d’y rester longtemps et de se soustraire de la sorte aux diverses corvées. Mais inviolable aussi, non pas tant parce que la porte se fermait de l’intérieur que parce que, situé chez nous de l’autre côté de la rue, au fond du jardin, ma mère ne se donnait pas la peine de venir nous en déloger. Malgré les mouches et les odeurs, j’ai adoré ces lieux si justement appelés retirés. J’y faisais de longues stations, à épier la vie à travers les fentes des planches et, surtout, à lire.
Grâce à eux, vers l’âge de huit ans, je traversai une crise frénétique de La Fontaine. Par je ne sais quel hasard, dans le coin où l’on mettait la réserve de papier journal indispensable à cet endroit, je trouvai un jour un recueil de Fables. Je ne saurai jamais comment un tel livre avait pu atterrir là puisque nous vivions dans une maison sans livres. Mais il y fut, je me l’appropriai, le cachant sous le plancher de la cabane pour ne pas risquer de le voir réduit en feuilles de papier hygiénique, et je me mis avec ivresse à en apprendre toutes les fables par coeur. J’eus la chance d’attraper à ce moment-là une diarrhée formidable qui me laissait à peine le temps de retraverser la rue entre deux séances de cabinets, et de fables. J’en appris une bonne dizaine dans la journée,sans même avoir à me sentir coupable de rester longtemps dans la cabane du jardin.
Maître Corbeau sur un arbre perché... « Qu’est-ce qu’un arbre perché ? » ironisa Jean-Jacques. J’eus, dans mes cabinets, tous les arbres-perchés les plus délirants, et, grâces soient rendues à la poésie, je les ai encore.
J’avais franchi les monts qui bornent cet État
Et trottais comme un jeune rat
Qui cherche à se donner carrière...
La Carrière, à Marcilly, était la décharge municipale. Quoi de plus naturel, pour un jeune rat, que de chercher à s’approprier un lieu où il trouverait certainement des monceaux d’aliments dé licieux à ronger ? C’était, en tout cas, beaucoup plus normal que de vouloir y entrer quand nos aînés n’y seraient plus. Ils n’y allaient jamais, nos aînés. Qu’est-ce que les grands seraient venus faire à la Carrière ? Il n’y avait que nous, les gosses, et, bien sûr, les jeunes rats.
Or, c’était un cochet dont notre Souriceau
Fit à sa mère le tableau
Comme d’un animal venu de l’Amérique...
Un cochet ? avec un t... Il se battait les flancs avec ses bras d’après le fils qui l’avait vu, et il devait servir quelque jour peut- être à nos repas d’après la mère. Alors, sans chercher plus loin, j’imaginais des scènes vaguement cannibalesques dont était victime un être à gros ventre et à chapeau rouge qui s’était d’abord dressé sur ses ergots et copieusement battu les flancs avec son fouet... de cocher.
Même s’il était plus long d’apprendre par coeur que de lire, j’apprenais vite et le recueil fut bientôt su. Je le rendis à la fonction à laquelle je l’avais frauduleusement soustrait, et je continuai à me réciter, pour le plaisir, des fables à demi ésotériques dont l’enchantement ne m’a jamais quittée.
Belle-Fiole, J.C. Lattes, 1980, page 72 et suivantes. © Danielle Rosadoni
L’ECOLE PRIMAIRE
J’ai toujours trouvé que l’école était un lieu un peu étrange, à la fois préservé et imprévisible. Plus calme qu’à la maison, bien sûr, mais, là non plus, les choses ne tournaient jamais comme on s’y attendait, la moindre étrangeté n’étant pas qu’elles y tournassent parfois mieux que ce qu’on escomptait. On y récitait beaucoup de prières dont l’une, surtout, me ravissait : il y était question d’une conjugaison dont le prix montait et redevenait raisonnable par l’intermédiaire d’un petit chat : « Et le verbe s’est fait cher, et il est descendu par Minou. » Dans ma ferveur je voyais la Sainte Vierge qui tenait dans ses bras, au lieu de l’Enfant Jésus, ma chatte Marquise et pouvait s’acheter grâce à elle de jolis petits verbes pas chers.
Lorsque, avec mes trois ans vêtus du tablier de satinette noire de mon grand-père, je fis connaissance avec la classe, Mlle Catherine nous remit un morceau de carton percé de deux trous, une cordelière, et nous montra comment faire une boucle. Pourquoi fallait-il faire des boucles sur un carton en classe, alors que j’en faisais tous les jours aux lacets de mes souliers ?
Au-dessus de la porte de la cantine, il y avait un grand dessin représentant la poule-aux-oeufs-d’or éventrée, avec le texte de La Fontaine. Un jour, la maîtresse nous dicta la fable, nous la fit écrire dans nos cahiers, et nous demanda de l’apprendre en récitation. Quelle drôle d’idée ! Je la savais par coeur depuis longtemps, et c’était certainement le cas de toutes les autres.
« Mourir ne prend qu’un r parce qu’on ne meurt qu’une fois, mais nourrir en prend deux parce qu’on se nourrit plusieurs fois. » Le merveilleux raisonnement. Je n’avais guère de difficultés pour l’orthographe, mais, désormais, avec une règle pareille, j’étais parée pour les cas litigieux. Vint une dictée ou « le voleur se mit à courir... » Courrir ? courir ? Faut-il un r ou deux r ? Eh bien, c’est simple, j’applique le raisonnement : on court avec deux jambes, on court plusieurs fois dans sa vie, et surtout quand on est un voleur. Donc, trois raisons pour écrire courrir. Hélas ! non, il n’aurait pas fallu, le raisonnement, lui, ne marchait que sur une jambe, celle de nourrir/mourir.
En deuxième division, nous eûmes à traiter, comme sujet de rédaction : « Décrivez un coucher de soleil. » J’avais déjà lu ça quelque part. Consciente de commettre une malhonnêteté, j’écrivis cependant, en espérant que ce ne serait pas trop grave : Et le soleil ferma son gros oeil rouge sous une paupière de nuages. Quand la maîtresse rendit les cahiers, elle ne dit rien d’abord de mon devoir et commenta un par un ceux de mes camarades. Je commençais à trembler. J’avais honte d’avoir écrit cette phrase dont je sentais bien qu’elle était un peu ridicule. Toujours sans me rendre mon cahier, Mlle Bernadette (ce n’était déjà plus l’époque de Mlle Catherine) alla chercher dans la grande classe Mlle Rose qui vint elle-même lire à haute voix le texte de ma rédaction. Je me recroquevillais de peur et de confusion sur mon banc, mais, quand elle eut fini, Mile Rose ajouta :
— Voilà une bonne rédaction. J’espère que cela servira d’exemple aux autres et que Danièle n’en profitera pas pour ne plus faire d’effort.
Je continuais à avoir honte, mais, désormais, c’était du fait qu’il eût été si facile de berner les grandes personnes.
Belle-Fiole, J.C. Lattes, 1980, page 84 et suivantes. © Danielle Rosadoni
LES RANGS
Et puis ce fut l’internat, presque hors de la ville, sur une route blanche, « au diable vauvert » comme disait ma mère : une superbe bâtisse longue, neuve, blanche, flanquée de six ailes perpendiculaires qui s’allongeaient vers le parc. Dans chaque aile, au rez-de-chaussée, les études ; au premier étage, les dortoirs. Un autre monde. Des sols brillants, d’immenses fenêtres, des murs beiges et lisses, de l’espace, des tables vernies et une profusion de grosses lampes rondes et blanches qui pendaient du plafond au bout d’une tige chromée et m’impressionnaient beaucoup : c’était le symbole du luxe où j’étais tout à coup plongée.
Je crus imiter Nicole, la grande soeur qui avait elle-même la plume si prolixe pour décrire dans ses lettres tous les lieux où elle passait, et je lui envoyai une longue description enthousiaste de l’internat. Mon morceau de bravoure se terminait par une énumération détaillée du mobilier de la salle d’étude. Et, feignant la naïveté, comme si le simple langage était inapte à rendre compte de toutes les merveilles que j’avais sous les yeux, j’écrivis en point d’orgue : ... et au moins vingt lampes blanches grosses comme ça.
A la première occasion, Nicole commenta ma prose et tourna « les lampes grosses comme ça » en dérision.
— Tu n’as pas compris que les gestes ne suivent pas dans une lettre ? Raconter par écrit, ce n’est pas la même chose que de vive voix. Il faut songer que celui à qui tu écris ne te voit pas.
Je ne cherchai pas à détromper ma soeur, mais je fus humiliée et blessée de constater qu’une petite fille de onze ans ne pouvait pas se permettre d’être stylistiquement ironique, ni surtout de faire impunément de la fausse naïveté.
Les journées de l’internat étaient merveilleusement rangées
6 h 30. - Réveil, on fait son lit, on met de l’ordre dans sa cabine, on fait sa toilette, on s’habille. On se met en rang trois par trois et on passe à la cordonnerie se chausser. En rang, on descend devant l’étude.
7 heures. - En rang, on attend le signal de passer au réfectoire. Petit déjeuner. En rang, toujours trois par trois, pour sortir du réfectoire. On passe à l’étude prendre son cartable ; on enlève sa blouse d’internat en vichy à petits carreaux verts et roses et on met son manteau d’uniforme, marron.
7 h 30. - En rang, on attend le signal du départ vers le lycée. Trois kilomètres à pied trois par trois. Nous suivons l’ancienne voie du chemin de fer dont les traverses récemment enlevées nous donnent l’impression de marcher sur une gigantesque tôle ondulée. Sur cette partie du parcours, je vais le nez au sol pour éviter les flaques et calculer la longueur de mes pas de bosse en bosse. Je relève la tête pour la traversée du canal sur un pont de fer, où nous sommes assaillies par l’odeur de la manufacture de peaux qui se trouve là. Arbres le long du canal, perspectives sur l’eau sombre, arbres du champ de foire. Sur le champ de foire, en novembre, l’alambic et ses odeurs qui prennent à la gorge. De temps en temps, un campement de bohémiens des roulottes, des chiens, le regard calme et noir des femmes en jupes longues, des enfants partout. Et quand il y a la foire nous faisons un grand détour par le bas de la ville, qui nous prive du sol ondulé, du canal et des arbres. Puis nous arrivons sur une grande place où il y a un entrepôt de fruits et primeurs. Nous longeons une usine dont j’ai appris par coeur, et dans l’ordre où elle figure sur la façade, la litanie de spécialités que je débite d’un seul trait, en allon geant démesurément la première voyelle : AAAAAAA-LAMBICS CHAUDIERES RÉSERVOIRS TONNES ABREUVOIRS POMPES MOTEURS TUBES RACCORDS ROBINETTERIE TÔLES MÉTAUX. Après quoi, nous sommes en ville et il n’y a plus rien à remarquer.
Les rangs entrent au lycée par la grande porte et les surveillantes d’internat qui nous accompagnaient depuis le réveil disparaissent. Vestiaires, nous enlevons nos manteaux et revêtons la blouse d’externat, en vichy bleu roi avec un liséré blanc. Nous sommes désormais mélangées aux externes.
8 heures. - En rang, nous attendons le signal pour entrer en classe. Cours toute la matinée.
Midi. - Vestiaires, de blouse d’externat en manteau. Les pionnes d’internat reparaissent. En rang, nous attendons le signal pour repartir vers Monvert. Les trois kilomètres en sens inverse, les rues, l’usine, la grande place, le champ de foire, l’herbe, les arbres, le canal, la voie de chemin de fer, les cloches d’une église voisine quand le vent s’y prête.
Midi et demi. - Monvert, vestiaires, de manteau en blouse d’internat. En rang devant notre étude, nous attendons le signal pour passer au réfectoire. Déjeuner. En rang, sortie du réfectoire, courte récréation.
I h 30. - Vestiaires, de blouse en manteau. En rang et départ vers le lycée. Terre ondulée, perpendiculaires de l’eau noire, ALAMBICS CHAUDIÈRES RÉSERVOIRS TONNES ABREUVOIRS...
2 heures. - Le lycée, vestiaires, blouses, retrouvailles avec les externes auxquelles nous avons parfois demandé, bien que cela soit strictement interdit, de nous faire une course en ville. Les plus riches se font acheter des pâtisseries ou des chocolats. Moi, en plein été, quand il fait très chaud, et quand j’en ai les moyens, je demande à mon externe de confiance de bien vouloir m’acheter un citron. Alors, après les cours de l’après-midi, dans les rangs, en attendant le signal du départ, je plante les dents dans mon demi- citron, le jus acidulé m’éclate dans la bouche, et je m’y désaltère avec des grimaces et des frémissements refrénés..
4 heures. - En rang, retour vers Monvert, escortées des surveillantes d’étude ; les rangs, les romanichels ou l’alambic, la terre et l’herbe, l’eau et les platanes.
4 h 30. - En rang vers le réfectoire : pain, rassis le plus sou vent, avec chocolat ou pâte de fruits, thé. En rang vers l’étude.
5 heures à 7 heures. - Étude.
7 heures. - En rang vers le réfectoire, dîner. En rang vers la grande salle de récréation, ou le parc les soirs d’été, ou encore le Foyer Jaune, jusqu’à 8 heures.
8 heures. - Etude pendant une demi-heure pour les plus petites, une heure ou une heure et demie selon qu’on approche des classes terminales. En rang pour sortir de l’étude, en rang pour monter ; cordonnerie où l’on est supposé cirer ses chaussures, en rang vers le dortoir. Toilette - de luxe, chacune ayant sa petite cabine individuelle et la possibilité de prendre une douche -, quelques minutes de détente où nous pouvons aller bavarder - mais silencieusement ! - les unes chez les autres ; puis la pionne donne le signal de la nuit, chacune rejoint son box, tire son rideau, se couche et s’endort.
Cette vie me convenait. Elle était simple, pratique, et surtout sans pièges. Si l’on en suivait les règles et l’ordonnancement, il n’y avait pas de mauvaises surprises. Et inversement, il fallait faire expressément ce qui était interdit pour être punie.
Il était interdit de sortir dans le parc par les escaliers de service - il y en avait un au bout de chaque aile -, de monter au dortoir dans la journée, de faire passer du courrier par les externes, ou d’introduire à Monvert des livres autres que ceux de la bibliothèque, qui ne fussent pas contresignés par Mme le censeur. J’ai naturellement organisé quelques expéditions inédites dans le monte-charge des cuisines ou dans les escaliers défendus, de même que j’ai enfreint bon nombre de lois non écrites en faisant des caricatures de pionnes ou de profs, ou, plus souvent encore, en imitant les autorités qui s’y prêtaient le mieux : Mlle Plat ( un deux-trois-quêtre, levez le petit doigt... ») ; Chlorophylle, un prof d’histoire-géo toute ronde, très susceptible et toujours habillée de vert ; Autrui, la longue et grise planche à pain en socquettes blanches qui nous conseillait inlassablement de nous préoccuper des autres ; Tête d’Hareng Saur, le malheureux garçon de laboratoire bégayeur qui fut longtemps le seul mâle à l’intérieur de notre gynécée. Quand j’étais en seconde, Tête d’Hareng Saur eut enfin un concurrent, un prof de math à béret, à lunettes rondes, à bouche distendue, flottant dans un immense pantalon à bretelles, qui marqua l’apothéose de ma carrière d’imitatrice.
La menace de renvoi pour les fautes graves était toujours à l’horizon, mais, ai-je bien calculé mes risques, ai-je eu la chance de n’être pas prise sur le fait, je ne me souviens pas d’avoir été en situation difficile.
Quant à mes autres sottises, elles ne devenaient jamais que ce qu’elles étaient. Si je parlais dans les rangs qui devaient être silencieux - et devaient être silencieux tous les amples mouvements de ballet à l’intérieur de l’internat -, je m’attirais, comme n’importe qui, un « Taisez-vous, Danièle Audret ». Si j’avais failli à l’utilisation de la brosse et du cirage, Mme le censeur, qui nous observait à la sortie de la cordonnerie, me lançait un grondeur :
— Eh bien, Danièle Audret, on n’a pas encore ciré ses chaussures, hein ?
Et c’était là tout. Ni le bavardage ni la négligence cordonnière ne s’enflaient démesurément pour devenir catastrophiques.
D’autre part, j’ai tout de suite été émerveillée, non seulement par les lampes « grosses comme ça », la propreté et la modernité de l’internat, mais aussi par tout ce qui nous était individuellement réservé : j’avais, comme tout le monde, mon bureau et mon placard en étude, mon casier à l’entrée du réfectoire, mon casier à la cordonnerie, ma cabine de toilette et ma cabine au dortoir.
Et on mangeait bien. Les repas étaient abondants, avec de la viande ou du poisson tous les jours, une entrée ou un potage, un plat, salade ou fromage, dessert. Je découvrais des mets étranges et raffinés comme les olives ou les yaourts, la choucroute ou le gratin dauphinois. Pour comble, on changeait d’assiette au moins deux fois, après le hors-d’oeuvre et avant le dessert. Ce détail, plus encore que les lampes, les tables vernies ou la cabine de toilette, symbolisait la grande vie que je menais à l’internat. Mais, dans un premier temps, il me choqua par son exagération que je trouvais presque ridicule, et je le racontai comme tel, innocemment, à mes premières vacances à la maison. Il n’y eut pas, d’abord, de réponse, mais, au repas suivant :
— Essuie ta coinche, mademoiselle ! T’es pas dans ton beau monde ici. Ah ! c’est pas assez bon pour toé d’ manger dans la même assiette ! Mademoiselle s’imagine qu’è va prendre des habitudes de princesse. Non mais, pis quoi encore ? En v’là des manières... Dire que tout e’ qu’on fait pour celle-là faut qu’ ça s’ retourne contre vous. On la lâche un mois, on l’envoie au lycée, et v’là l’ résultat : Mademoiselle nous trouve pus assez bons pour elle. De deux choses l’une, ou ben tu vas changer d’ manières, ou ben tu r’mets pus les pieds ici, c’est compris ?... Et pis c’est pas la peine de répondre, mal polie.
Et voilà. Un bavardage totalement innocent - car, vraiment, j’avais raconté la chose comme une curiosité - s’enflait démesurément et prenait des proportions catastrophiques. Mon départ de la maison n’avait rien changé, au contraire : je retrouvais la culpabilité inévitable, la parole impossible et l’accablement. Je fus soulagée de rentrer à Monvert le lendemain, étonnée de voir que plusieurs de mes camarades pleuraient.
La plupart d’entre elles se plaignaient beaucoup des repas qu’on nous servait. Elles prétendaient que les sardines n’étaient pas fraîches, que les pâtes étaient mal cuites, qu’il y avait trop de gras dans les morceaux de viande. D’ailleurs, elles n’aimaient ni les sardines, ni les pâtes, ni cette viande-là. Elles avaient besoin de suppléments et presque toutes recevaient des colis de gâteaux, chocolats, confitures, biscottes et, ce qui me faisait peut-être le plus envie depuis que Michelle Velcomme m’en avait fait téter une gorgée, du lait concentré sucré en gros tube.
Elles avaient sans doute raison, je voyais bien qu’elles chipotaient dans leur assiette, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et je me régalais sans oser le dire.
La règle du silence dans les évolutions du corps de ballet entre étude et réfectoire, entre dortoir et cordonnerie, ne me paraissait pas toujours évidente. Mais je la trouvais, en revanche, tout à fait justifiée et fort pratique en étude ou au Foyer Jaune. N’était-ce pas le simple bon sens que de ne pas faire de bruit en ces endroits-là ? Puisque l’étude était prévue pour le travail, la lecture, les devoirs, et que tout cela était empoisonné par les bavardages, pourquoi y avait-il toujours des filles qui y papotaient ? Puisque le Foyer Jaune était réservé à celles qui voulaient écouter de la musique pendant les récréations, que personne n’était obligé d’y venir, que, pendant ce temps, la grande salle était ouverte à tous les bruits et tous les cris, pourquoi certaines éprouvaient-elles le besoin de venir y parler et gâcher ainsi notre plaisir à Wilhelm Kempf ou Bruno Walter ? Cela non plus, je ne le comprenais pas, mais je n’arrivais pas à l’admettre. L’agacement me gagnait, puis j’étouffais de rage, et j’exigeais le silence en lançant des « Chut » intolérants.
Si je supportais mal ce manquement de mes camarades à la discipline, je supportais plus mal encore un règlement que je trouvais absurde : celui de la promenade obligatoire les jeudis et dimanches. Que les directives de l’administration eussent prévu de telles promenades de santé pour les pensionnaires qui habitaient dans leur lycée comme ç’avait été le cas à Meaux, par exemple, c’était compréhensible ; mais nous, pourquoi fallait-il nous y contraindre ? Alors que, par la force des choses, nous prenions l’air quatre fois par jour, tous les jours de la semaine, pourquoi fallait-il encore nous traîner en troupe pendant deux heures dans les rues de la ville les jeudis et dimanches sous prétexte que la promenade bi-hebdomadaire était inscrite dans un règlement imbécile ? Et pourquoi fallait-il que je fusse la seule à m’insurger ?
Je raisonnais, j’argumentais, je rappelais nos quatre trajets quotidiens ; j’invoquais le travail et ces deux heures perdues. Quand il y avait un film ou un spectacle auquel on menait celles qui en avaient les moyens, je lançais sournoisement que les filles n’allaient pas prendre l’air dans une salle de cinéma, alors pour quoi nous ? Mais le règlement était inflexible.
J’ai tout fait pour y échapper. Je me suis cachée dans les toilettes ; j’ai feint de m’endormir au fond du parc et de ne pas entendre le signal. Avant les représentations de No ou de fin d’année scolaire, j’ai parfois demandé une dispense officielle pour apprendre un rôle que je savais déjà par coeur. Je me suis astreinte à boiter pendant des journées entières pour légitimer mon refus de sortir. Et surtout, me souvenant à propos de la méningite de mes neuf ans, j’ai eu régulièrement, les jeudis et dimanches, vers deux heures moins le quart, des rechutes sous forme de violentes migraines qui nécessitaient un séjour de plusieurs heures dans une pièce obscure de l’infirmerie, alors que mes camarades trottaient au soleil dans quelque jardin de l’Archevêché. Tout, plutôt la démarche faussement claudicante, plutôt les toilettes, plutôt l’immobilité dans le noir, que de me plier à accepter ces promenades honnies qui me faisaient enrager, et auxquelles je dus pourtant me soumettre quelquefois.
Les rangs entre Monvert et le lycée, ce fut donc, pendant les sept ans de mes études secondaires, deux heures et douze kilomètres par jour, par tous les temps. Eux ne m’ont jamais pesé.
Belle-Fiole, J.C. Lattes, 1980, page 120 et suivantes. © Danielle Rosadoni
UNE FIGURE DE PROFESSEUR : MME FALLEE
Je ne me sentais pas spécialement attirée par les sciences, matière relativement secondaire pour une élève de classique et qui devait être plus ou moins la continuation des ennuyeuses « leçons de choses » de l’école primaire, mais je l’étais par les sciences naturelles enseignées par Mme Fallée. Ses cours étaient tous admirables de clarté, et si vivants qu’ils en devenaient essentiels. Il lui suffisait de sortir de l’armoire vitrée du laboratoire un vieil oiseau empaillé tout poussiéreux pour qu’aussitôt on eût sous les yeux un animal au plumage lisse et brillant, prêt à voler librement dans la forêt pour y faire son nid et chercher pâture à ses petits. Du coup, tous ceux qui restaient alignés derrière les vitres de l’armoire et attendaient d’être éveillés par elle nous donnaient envie de connaître leur histoire.
Le tout-puissant programme était à la fois respecté comme il convenait et gentiment bousculé si elle en avait l’occasion. Un lundi, elle déroula, sur la table aux carreaux de faïence blanche, une couleuvre qui ressemblait un peu au serpent du Petit Prince ayant avalé un éléphant. D’après elle, l’éléphant de la couleuvre était un crapaud. Elle la disséqua devant nous, et, en effet, intact dans l’estomac du serpent, apparut un gros crapaud. L’heure de travaux pratiques de ce jour-là fut une aventure palpitante : nous la suivions avec ses deux grands fils dans sa promenade du dimanche, nous entendions le glissement du serpent qui se sauvait sur les feuilles du sous-bois ; le fils aîné s’élançait et, d’un coup de trique bien appliqué, assommait la couleuvre qui mourait sans souffrir. Naturellement, si j’avais eu une telle mère, moi non plus je n’aurais pas eu peur des serpents. Les deux fils Fallée n’avaient pas grand mérite. Si j’avais osé, je crois que je les aurais enviés. Elle y faisait allusion parfois, dans des cas comparables, n’étant point de ces professeurs qui affectent d’être artificiellement réduits à leur rôle de machine à enseigner. Et pourtant, sans être jamais distante, elle n’était non plus jamais familière. Elle avait une telle autorité, un tel prestige, qu’elle pouvait nous parler simplement de sujets aussi scabreux que l’hygiène intime sans qu’aucune d’entre nous y trouvât matière à ricaner. C’est donc aux cours de sciences naturelles que j’avais appris la véritable fonction du bidet de ma cabine de toilette, lequel ne servait pas uniquement à se laver les pieds, et la nécessité de se laver « le bas » tous les jours et pas seulement une fois par semaine.
En même temps que notre classe de sixième II puis de cinquième II, elle eut les classes de sixième I puis cinquième I, parallèles aux nôtres. Elle nous disait parfois que les « I » étaient plus brillantes que nous et j’en souffrais. Aussi eus-je l’impression de m’élever dans sa considération quand, à la faveur de mes débuts en grec, je passai en quatrième I puis en troisième I. Alors, le quartz et le granit, qui devinrent par elle aussi fascinants que les oiseaux et les couleuvres, brillèrent de l’éclat supplémentaire des I.
En troisième, quand je revins au lycée après la mort de mon père, pour le premier cours de sciences naturelles qui suivit mon retour, elle se tint à la porte de la classe, semblant surveiller l’entrée de notre troupe. J’étais, comme toujours, au dernier rang. Elle m’arrêta, m’étreignit et m’embrassa sans rien dire. Son geste était si inattendu, si fort et si simple qu’il eut le don de relâcher l’étau de terreur qui m’enserrait les côtes et de me permettre mes premiers sanglots libérateurs. Elle avait su éviter les attitudes fausses, gênées ou compassées, qui me mettaient mal à l’aise.
Au printemps, elle demanda à Mme le censeur l’autorisation de me faire sortir de l’internat un dimanche, en même temps qu’une autre pensionnaire, Christine Despierres. C’était un grand événement qui nous rapprocha et nous fit longuement bavarder aux récréations, Christine et moi. Pour l’occasion, Christine me prêta une veste de gabardine beige dans laquelle je me sentais présentable. J’étais à la fois soulagée de ne pas être seule avec Mme Fallée et jalouse de ne pas l’être. Mais j’étais surtout morte de trac. Une si grande dame ! Saurais-je bien me tenir et ne pas sembler trop rustaude ? A cause de mon trac, j’insistai pour que ce fût Christine qui prît place à côté d’elle à l’avant de la 4 CV. Elle nous introduisit dans une grande demeure intimidante : il y avait des centaines de livres, des tableaux aux murs, des fauteuils, un piano, et une « chaîne » dont elle fit apparaître la platine en manoeuvrant un tiroir. C’était son deuxième fils, le physicien, qui la lui avait construite.
— Vous aimez la musique ? Nous en écouterons cet après- midi si vous voulez. Maintenant, nous allons déjeuner.
Christine avait déjà, sans doute, déjeuné chez une personne de cette classe. Elle était beaucoup plus distinguée que moi et ne semblait pas particulièrement impressionnée. J’enviais son calme. Ma terreur fut à son comble quand Mme Fallée nous servit du canard aux petits pois. Je ne fis pas une seule fois le geste périlleux qui consistait à porter une fourchette de petits pois à ma bouche sans être saisie, en pensée, d’un tremblement spasmodique qui me faisait répandre les petits pois meurtriers sur moi, sur la nappe blanche, sur les vêtements de Mme Fallée et de Christine, et sur la totalité du plancher où ils bondissaient furieusement dans tous les coins. Enfin mon assiette fut vide, sans autre dommage que les désastres que j’avais vécus dans mes transes d’imagination.
— Vous n’avez pas beaucoup mangé, Danièle, je vous ressers ?
— Oh ! non, merci, madame, je... C’est très bon, mais je n’ai plus faim.
Pour authentifier mon refus, je feignis de ne pouvoir goûter à un crottin de Chavignol pourtant dur à point, et je chipotai sur une petite cuillerée de dessert. Mais je crois aussi que l’appétit m’avait quittée. Le café qu’on prit au salon, dans une minuscule tasse toujours prête à glisser sur une soucoupe où devait tenir également une petite cuiller dorée, renouvela mon épreuve et mes terreurs.
Heureusement, je pus reprendre ma place, recroquevillée à l’arrière de la 4 CV. Il faisait beau, la campagne était fleurie, Mme Fallée nous fit faire une promenade sur les petites départementales de la région, jusqu’aux ruines d’un château qui semblaient maintenues debout par une carapace de lierre.
— Vous pouvez aller voir le panorama de là-haut ; moi, je vais marcher tranquillement ici sous les arbres.
Je courus sur le chemin, faisant glisser des cailloux, bruyante avec Christine, exubérante, faisant la folle pour capter de loin l’attention de Mme Fallée, alors que je ne songeais qu’à rester près d’elle dans l’ombre fraîche à voir palpiter la ruine enlierrée contre le ciel bleu.
Quand nous fûmes de retour dans la maison aux livres et aux tableaux, elle posa un disque dans l’étrange tiroir à électrophone. C’était le Requiem de Mozart. Alors, sous la houle de la musique et des voix qui enflaient, toute l’émotion de la journée me submergea. Je ne pouvais plus résister. Dans l’immobilité forcée du fauteuil, n’ayant plus le dérivatif d’une course sur les cailloux, ne pouvant plus me cacher sur le siège arrière d’une voiture, offerte aux regards, je me sentis perdre pied. M’envahissaient, bouillonnaient et tourbillonnaient en moi le trac et la nervosité qui me nouaient depuis le matin, l’intensité déroutante d’une journée exceptionnelle, l’incongruité de ma présence ici, et les élans retenus qui auraient voulu me projeter vers Mme Fallée pour pleurer de tendresse à ses pieds. Je sortis pour m’abandonner à mes pleurs dans le jardin. Elle ne vint m’y rejoindre qu’au bout d’un certain temps.
— Pleurez, mon petit, c’est bien naturel. Excusez-moi d’avoir mis ce disque-là, j’aurais dû y penser.
Elle avait donc cru que je pleurais sur la mort de mon père ! Elle m’entoura les épaules de son bras et me tint ainsi un long moment pendant lequel, seule avec elle sur le banc de son jardin, mes larmes justifiées par une raison plausible qu’elle avait trouvée, je me laissai aller aux sanglots avec un soulagement dont les bulles crevaient doucement en moi et qui ressemblait à une vague de bonheur.
Belle-Fiole, J.C. Lattes, 1980, page 186 et suivantes. © Danielle Rosadoni
Danièle Rosadoni, bibliographie.
Poésie :
Prière pour ce jour-là, Ed. Saint-Germain-des-Prés (épuisé)
Collaborations avec des artistes plasticiens :
Nocturne, édition bibliophile, H.C., avec des sérigraphies du peintre danois Hans Meyer Petersen.
Rosadoni-Ramette, édition bibliophile H.C., textes sérigraphiés par le peintre Patrick Ramette.
Poèmes pour Roland Cat, catalogue d’exposition.
Sur l’oeuvre de Pakciarz, sculpteur, catalogue d’exposition.
Publications dans diverses revues ou livres collectifs.
Romans :
Belle-Fiole, Editions J.C. Lattes
L’amour par correspondances, Ed. Denoël
Traductions :
Les enfants de l’hiver, de Dea Trier Mørch, Ed. Denoël, traduit du danois.
Visages, de Tove Ditlevsen, Ed. Stock, traduit du danois.

